Prêtés par Covent Garden
À l’époque, Londres comptait sept orchestres, deux maisons d’opéra, trois compagnies de ballet et vingt-six théâtres, de quoi tenir des centaines, sinon des milliers d’artistes occupés. (Si le lecteur est curieux, il peut aller consulter les registres de l’Union des artistes et comparer, à proportion de la population, le nombre de nos artistes qui travaillent.)
 Les chanteurs de Covent Garden étaient «mobiles» : on nous prêtait parfois à d’autres compagnies. C’est ainsi que le ROH m’a envoyé chanter Les Noces de Figaro et L’Heure espagnole en tournée avec la troupe de Sadler’s Wells ..
Les chanteurs de Covent Garden étaient «mobiles» : on nous prêtait parfois à d’autres compagnies. C’est ainsi que le ROH m’a envoyé chanter Les Noces de Figaro et L’Heure espagnole en tournée avec la troupe de Sadler’s Wells ..
Au Sadler’s Wells j’ai retrouvé avec plaisir un bon ami canadien, devenu directeur musical de la compagnie: Mario Bernardi.
J’avais rencontré Mario en 1956 à Toronto, à l’occasion d’une production de Carmen que dirigeait un vieux chef d’orchestre grincheux du nom de Ernesto Barbini. Mario était alors pianiste accompagnateur à la Canadian Opera Company. A la première répétition, je me suis adressé à lui en italien, ce qui a scellé tout de suite nos bons rapports.
Der Freizchiitz
Cette saison-là, la compagnie Sadler’s Wells affichait, en même temps Les Noces de Figaro, un des opéras les plus pompiers que je connaisse: Der Freischiitz de Weber. Les deux œuvres étaient chantées en anglais.
Dans Freischiitz, Max, le héros-ténor, est amoureux d’Agathe et veut l’épouser. Pour obtenir sa main, cependant, il doit se plier à une exigence singulière du père de la jeune fille. Il doit réussir à abattre six cibles au fusil sans en manquer une. Max est désespéré. Il ne sait pas viser.
Par bonheur, il entend parler d’un certain Caspar (la basse Donald McIntyre) qui loge dans la montagne et fabrique des boulets magiques. Ces boulets ne ratent jamais leur cible, un peu comme les missiles téléguidés durant la guerre du Golfe. Quand Max arrive chez Caspar, celui-ci est justement à l’œuvre devant une immense marmite pleine de métal en fusion. Attendri (!) par l’histoire du jeune homme, le magicien commence à préparer des moules pour les six boulets.
Qu’on imagine le décor: une grande caverne éclairée de verts, jaunes et rouges vifs traversés d’éclairs menaçants. À l’orchestre, les tambours, les cymbales et les trompettes éclatent. Tout à fait l’ambiance qu’il faut pour mettre Max à l’aise.
Au milieu de ce fracas, Caspar coule le premier boulet en comptant lentement, de sa grosse voix grave: 0NE!!! L’écho de la montagne (le chœur en coulisse) répond: 000NNNE!!! Autre sombre grondement de l’orchestre, suivi d’un immense: TWO!!! Et l’échode répéter: TWOOO!!! Troisième vrombissement des cymbales: THREE!!! – THRREEE!!!, reprend l’écho. À travers l’énorme tumulte, Caspar lâche un gigantesque: FIVE!!!
Et on entend l’écho qui tonne: FOURRRRR!!!…
Le public a craqué. On n’entendait plus ni l’orchestre ni le chanteur tellement les gens riaient. À la fin de la représentation, je sors de la salle en trombe et cours frapper à la loge de McIntyre. Je ne répéterai pas le juron qui a traversé la porte. Mon pauvre collègue n’a parlé à personne pendant des jours.
Cela n’a pas empêché Max de marier Agathe.
On dirait que Freischiitz attire les mésaventures. Je revois encore notre Max de Covent Garden, dans une autre production, arrivant au concours de tir avec ses six boulets.
«Tu vois la colombe blanche là-haut dans cet arbre? Lui demande le père.
– Oui.
– Tire et descends-la.»
Max met son arme en joue et fait feu. Du haut des airs on voit s’écraser … un gros volatile à longues plumes noires. La feuille de régie portait l’instruction: Throw bird. Personne n’avait spécifié au machiniste que c’était une colombe blanche qu’il fallait envoyer valser!
Là encore, Max a marié Agathe et ils eurent beaucoup d’enfants.
Deux semaines après, le soir de la générale, en entrant en scène pour l’air du Toréador, j’aperçois au pupitre non pas le désagréable Barbini mais le jeune Mario! Je me suis incliné très bas devant le nouveau maestro. Bernardi prenait en effet le bâton pour la première fois.
Mario s’est acquis depuis une réputation mondiale, ce qui n’a rien d’étonnant. Il possède une qualité très rare chez les chefs d’orchestre: il excelle à la fois dans la symphonie et dans l’opéra, qu’il adore de toute sa fibre italienne. Je n’ai que de beaux souvenirs des Mozart, des Rossini et des Berlioz que nous avons faits ensemble. Par l’entremise de Bernardi, j’ai d’ailleurs fait la connaissance d’une autre grande dame de l’opéra, la charmante Frederica Von Stade, l’une de ses plus fidèles admiratrices.
La direction de Covent Garden m’autorisait aussi à chanter pour le Scottish Opera. J’adorais ces escapades dans le beau pays d’Écosse. Avec mes collègues, je logeais dans un petit village près du lac Loman, à trente kilomètres de Glasgow. Nous chantions des Faust, des Butterfly, des Bohème et d’autres opéras du répertoire courant pour les sympathiques Écossais.
Falstaff au Scottish Opera
Un soir, à 17 heures, comme je sortais du King’s Theatre à Glasgow après une pleine journée de répétition pour Faust, Peter Hemmings, le directeur général de la compagnie, me rejoint à la porte et me demande à brûle-pourpoint:
«Tu connais Falstaff ?
– Oui», lui dis-je.
Je m’apprêtais alors à rentrer à l’hôtel pour faire ma toilette et revêtir mon habit de cérémonie. En effet, le grand gala d’ouverture de la saison avait lieu ce soir-là. Juste avant le lever du rideau, tous les artistes à l’affiche de la saison devaient être présentés officiellement au public devant les journalistes et critiques du monde entier, dont celui du Times de New York.
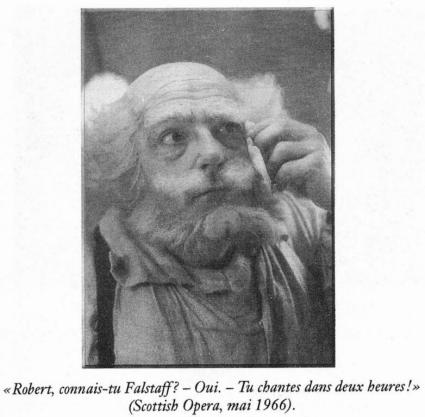 «Oui, je connais Falstaff. Pourquoi?
«Oui, je connais Falstaff. Pourquoi?
– Eh bien, Geraint Evans a perdu la voix et ne peut pas chanter ce soir. You’re on, Bob!»
Je n’avais pas regardé la partition depuis deux ans (trois cents pages, on s’en souviendra … ) et je n’avais assisté à aucune répétition depuis mon arrivée, étant pris tous les jours par celles de Faust. «Me donnez-vous cinq minutes pour y penser?»
Pour toute réponse, le directeur m’entraîne dans la loge du pauvre Geraint, que je connaissais bien pour avoir été sa doublure au Garden. Affaissé sur sa chaise, mon collègue souille d’une voix tout enrouée: «Hi Bob! I lost my voice. Can’t sing. Can you do it ?»
Comme si Falstaff était Frère Jacques!?! Mais je n’ai pas vraiment le choix. C’est la soirée la plus prestigieuse de la saison, il faut accepter.
Le rideau se lève dans une heure quarante-cinq minutes.
C’est à peine le temps qu’il faut pour créer physiquement le personnage de Falstaff.
Geraint me donne un coup de main pour le maquillage, qui est très compliqué. Il faut m’arrondir le visage à petits coups de pinceau, dessiner des sourcils blancs, des yeux sombres, ajuster ensuite la perruque, coller la moustache et la barbe. Enfin, je suis prêt à enfiler le costume, une combinaison rembourrée depuis les genoux jusqu’aux épaules et qui pèse douze kilos.
Il reste maintenant un quart d’heure pour me concentrer sur la musique de la première scène. Je verrai au reste pendant le deuxième tableau et l’entracte. Personne ne sait encore que Geraint ne chante pas, y compris sir Alexander Gibson, le chef d’orchestre.
Les collègues commencent à lancer All the best ! en frappant à la porte de Geraint. (En France, on dit le mot de Cambronne, en Allemagne c’est Toy toy!, en Amérique Break a leg! en Italie ln bocca al lupo!). Je réponds Thanks! En ouvrant, mes visiteurs ne me reconnaissent pas. Mais la nouvelle fait le tour des loges comme une traînée de poudre. Toute la distribution est soudain sur le qui-vive.
Sir Alex accourt à son tour.
« Est-ce que tu chantes à la Solti, à la Giulini ou à la Verdi?
– Verdi.
– Bravo, on va bien s’entendre.»
Il faut savoir que chaque chef d’orchestre apporte sa touche personnelle aux partitions. Mais ce soir-là, il n’est pas question de touches personnelles, ma partition annotée, je ne l’ai même pas avec moi.
A 18 heures 55, le metteur en scène, Peter Ebert, m’accompagne sur scène pour m’expliquer en trois phrases les entrées, les sorties et les accessoires. A 19 heures précises, Hemmings salue la foule qui remplit le théâtre. Tous les chanteurs, dont Geraint Evans, sont installés au premier rang de la corbeille. Hemmings les présente un à un, puis annonce que Robert Savoie remplacera Evans dans le rôle de Falstaff. Applaudissements nourris. Le rideau se lève. C’est parti.
Je suis d’un calme olympien. Aucun trou de mémoire durant la première scène. A l’entracte, je demande à Alex un raccord pour la très difficile fugue finale. Dans ce morceau, les dix personnages principaux et le chœur chantent tous en même temps des textes différents. Les risques d’accrocs sont légion. Évidemment, tous mes collègues acceptent.
Le deuxième acte se déroule lui aussi sans la moindre anicroche. À la fin, c’est l’ovation debout (à l’époque, le phénomène était encore rare). L’adrénaline me gonfle les veines. Revenu dans ma loge au milieu de mes amis, je trouve un magnum de champagne, un billet de cent pounds et une bouteille de scotch Grant’s de la part du président du Scottish Opera, qui était PDG de la compagnie Grant!
Le lendemain, je me suis présenté au théâtre pour la générale de Faust sans avoir fermé l’œil de la nuit. Deux jours qu’il a fallu pour détendre le ressort!
Pas de commentaire